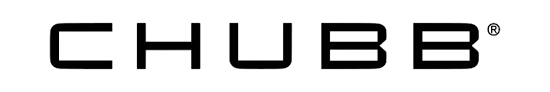Bien qu’essentiels à la renaissance du secteur, ils font face à des risques de responsabilité spécifiques et sous-estimés.
Avec 57 réacteurs opérationnels d'une capacité combinée de 63 000 mégawatts (MWe), la France reste le leader incontesté de la production d'énergie nucléaire en Europe et le plus grand exportateur net d'électricité au monde. Cette réalité est le fruit de la vision de dirigeants politiques et industriels qui, dès les années 1960 et 1970, ont perçu le potentiel de l'énergie nucléaire comme facteur d’indépendance, ainsi que d'une longue tradition de coopération étroite entre scientifiques, techniciens, exploitants de centrales et EDF – tous bénéficiant d'un haut niveau de confiance et d'adhésion du public.
Mais il ne faudrait pas oublier un autre ingrédient clé de cette réussite, qui est le vaste réseau de sous-traitants et prestataires qui fournissent aux centrales nucléaires les équipements, technologies et services spécialisés nécessaires pour garantir le haut niveau de disponibilité et un fonctionnement sécurisé des réacteurs. Avec une part d’environ 65 % de l’électricité nationale provenant du nucléaire, cette chaîne de sous-traitance est d’une importance capitale pour l’indépendance énergétique de la France.
Les nombreuses entreprises qui conçoivent, produisent et entretiennent les composants et équipements des réacteurs électronucléaires travaillent généralement également pour d'autres secteurs d’activité, tels que la chimie ou l’industrie du pétrole et du gaz. Les risques de mise en jeu de leur responsabilité en cas de produits défectueux ou en cas d’erreur de maintenance entrainant un arrêt d’une usine chimique ou d’une raffinerie sont généralement bien identifiés par ces entreprises. Elles ont conscience également qu’une assurance responsabilité civile constitue un transfert efficace de tels risques.
Cependant, dans le secteur nucléaire, certains incidents peuvent conduire à une augmentation de la radioactivité ou la libération de matières radioactives, au sein même de l’enceinte de la centrale nucléaire. La plupart des polices d'assurance responsabilité civile standards contiennent des exclusions spécifiques lié aux événements de nature radiologique, dont les entreprises n’ont souvent pas conscience. Pour se protéger, les prestataires et sous-traitants doivent s'assurer qu'ils sont pleinement couverts pour ces risques d’origine radiologique. Dans le cas contraire, ils doivent prendre des mesures pour obtenir une protection adaptée à l’ensemble de leurs activités.
La France, comme d’autres pays dans le monde, applique depuis longtemps un régime de responsabilité objective aux exploitants d'installations nucléaires, conformément à la Convention de Paris de 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. En pratique, cela signifie que l'exploitant d'une centrale nucléaire est légalement responsable de tout dommage résultant d'accidents provenant de l'installation ou lors du transport de matières nucléaires, qu'il soit ou non en faute. Cette responsabilité objective a conduit à la création d'Assuratome, le pool national de coassurance pour les risques de responsabilité des exploitants de centrales nucléaires en France. Avec une capacité de 700 millions d'euros, Assuratome répartit les risques entre ses 33 membres (à ce jour) en cas d'accident ou d'incident entraînant la libération de matières radioactives hors d'une installation.
L’écosystème des concepteurs, fabricants, fournisseurs ou prestataires en maintenance, dont les produits et services sont essentielles à la production électronucléaire française, ne peuvent toutefois quant à eux, que recourir à des solutions d'assurance plus conventionnelles, telles que les polices de responsabilité civile générale couvrant les risques tels les dommages corporels ou matériels. Cependant, ces polices excluent généralement la couverture des responsabilités liées aux produits destinés à une centrale nucléaire, et excluent généralement également les prestations de services telle la maintenance sur ces équipements installés en centrale. « Nous estimons qu'environ seulement 5 % de ces entreprises disposent d'une police d’assurance couvrant ce type de responsabilité spécifique » indique Alexandre Milosevitch, Miller Insurance ; « et parmi ces dernières, près de 90 % sont de grandes entreprises ». Cela créé potentiellement un « trou de garantie » significatif – en particulier pour les centaines de PME PMI, prestataires et sous-traitants– que le secteur nucléaire ne peut se permettre d'ignorer.
On distingue habituellement deux sections distinctes, appelés « ilot », dans un réacteur électronucléaire : l’îlot nucléaire, où le processus de fission génère de la chaleur, et l’îlot conventionnel, où cette chaleur est utilisée pour produire de l’électricité. Bien que les deux sections soient essentielles au fonctionnement de l’installation, seule la première – l’îlot nucléaire – contient les matières radioactives. Les équipements de l’îlot nucléaire jouent également un rôle clé dans la gestion de trois fonctions de sécurité critiques :
- Refroidissement du combustible : Évacuation de la chaleur résiduelle générée par la fission ou la décroissance radioactive des produits de fission.
- Contrôle de la réactivité : La fission nucléaire implique une réaction en chaîne qui doit être strictement contrôlée pour éviter une progression exponentielle.
- Confinement des produits radioactifs : par le biais de trois barrières physiques successives entre les matières radioactives et l’environnement.
L’îlot conventionnel ne contient aucune matière radioactive ; certains circuits auxiliaires qui s’y trouvent, cependant, sont toutefois essentiels pour garantir la sécurité globale de l’installation (tel que le refroidissement par exemple) et doivent également être pleinement opérationnels pour permettre la production d’énergie (à commencer par la turbine à vapeur).
La défaillance de l’un des composants de l’îlot nucléaire – par exemple, la rupture d’une ou plusieurs barrières de confinement – pourrait potentiellement entraîner la dispersion de matières radioactives au sein de l’installation, voire dans l’environnement. Si un équipement lié au contrôle de la réactivité venait à dysfonctionner, le réacteur pourrait subir un accident de criticité, où la réaction en chaîne des matériaux fissiles se poursuivrait au-delà du contrôle des opérateurs. Cela pourrait entraîner la dispersion de ces matériaux et, dans les cas les plus extrêmes, entrainer jusqu’à la fusion du cœur du réacteur. Ces scénarios pourraient exposer les travailleurs, et même le public, à des risques d’irradiation ou de contamination.
Lorsqu’un défaut ou un problème est identifié dans l’îlot nucléaire d’une installation – même si aucune matière radioactive n’a été libérée – cela déclenche un processus de mise en sureté, d’investigation et de notification, long, détaillé et potentiellement couteux. Tout d’abord, l’exploitant est tenu de notifier l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), l’organisme de régulation officiel qui supervise toutes les activités nucléaires civiles au nom du gouvernement français. L’ASNR peut alors décider, en fonction de la nature et gravité de l’incident, que la pièce ou l’équipement mis en cause doit être retiré et remplacé dans l’installation. Les coûts peuvent rapidement devenir très significatifs. En effet, étant donné la configuration de la centrale, les techniciens peuvent être amenés, afin d’accéder à l’équipement en question, à démonter les équipements environnants avant de pouvoir procéder au remplacement de la pièce défectueuse, puis de procéder au réassemblage de l’ensemble. Si la pièce défectueuse a entraîné une rupture du confinement et la libération de matières radioactives, les coûts liés à la remédiation et à la décontamination pourraient devenir très importants.
Selon le type et la gravité de la défaillance, un réacteur peut devoir être mis arrêt pendant une période considérable, jusqu’à plusieurs mois. Si une fuite sur une barre de combustible venait à être détectée, par exemple, le réacteur devrait être mis à l’arrêt. « C’est un processus long et couteux » indique Léna Bilde, ingénieur de risque chez Chubb. « L’exploitant doit d’abord permettre à la chaleur résiduelle du cœur de se dissiper, avant de pouvoir procéder à l’ouverture du circuit primaire afin de rechercher et d’identifier la barre de combustible incriminée et procéder à son remplacement. » Le processus est également coûteux : selon les prix de l’électricité, une journée d’arrêt d’un réacteur EDF peut coûter entre un million et dix millions d’euros par jour.
Entre 1978 et 2002, 58 réacteurs électronucléaires ont été construits en France. Pendant cette période, les installations étaient construites à un rythme soutenu : les travailleurs et les entreprises qui les ont bâties et entretenues ont acquis une grande expérience et expertise, constituant ainsi un groupe de spécialistes dont la connaissance approfondie de la conception des réacteurs les rendait indispensables pour résoudre les problèmes détectés. Depuis 2002, cependant, aucune nouvelle installation nucléaire n’a été construite en France, à l’exception de l’EPR de Flamanville 3, dont la construction, débutée en 2007, a été marquée par des retards et des dépassements de coûts, et qui n’a été mise en service qu’à la fin de l’année 2024.
Cette longue « pause » a eu pour l’industrie nucléaire Française un impact négatif sur le maintien et le transfert des compétences spécialisées, une génération de travailleurs du nucléaire ayant pris sa retraite avant de pouvoir transmettre tout son savoir à la génération suivante. Le sujet du maintien et transfert des connaissances et compétences existent dans d’autres industries ; dans le secteur nucléaire, cependant, il peut être critique. Parmi les trois types de PME/PMI que nous avons identifiés comme les plus vulnérables à une réclamation en responsabilité – à savoir les sociétés d’ingénierie et de conception, les fabricants et fournisseurs de rang 1, et les sociétés de maintenance qui les inspectent et les entretiennent – nous avons constaté que ce dernier groupe est le plus exposé et a donc le plus besoin d’une assurance responsabilité spécifique.
Une expertise française à l’international
Alors que de plus en plus de pays en Europe et dans le monde développent leurs programmes nucléaires, la demande internationale pour les produits et services spécialisés de prestataires et sous-traitants Français devrait continuer à progresser. Cependant, cette croissance s’accompagne d’une exposition accrue aux risques de responsabilité, et ce notamment dans des juridictions aux cadres réglementaires, juridiques et assurantiels différents.
Chez Chubb, notre expérience mondiale dans le secteur des technologies climatiques nous permet d’accompagner les entreprises françaises prestataires et sous-traitantes de l’industrie du nucléaire dans la gestion de leurs risques. Nos souscripteurs et ingénieurs de risques comprennent le secteur du nucléaire et sont pleinement conscients que la sureté des réacteurs nucléaires dépend des processus de fabrication, des services et des opérations de maintenance des milliers de composants individuels qui les constituent.
L’avenir de l’industrie du nucléaire français repose en partie sur sa capacité à protéger et maintenir sa chaine de prestataires et de sous-traitants, en anticipant les risques auxquels ils sont confrontés. En comprenant mieux leur exposition aux responsabilités – et en prenant des mesures pour les atténuer – les entreprises de taille intermédiaire qui interviennent dans les centrales nucléaires contribueront également à protéger les centrales nucléaires françaises et notre indépendance énergétique.
Ce document est d’ordre informatif et constitue une ressource à utiliser conjointement avec les recommandations de vos conseillers en assurance entreprise dans le cadre de votre programme de prévention des sinistres. Il s’agit d’une simple présentation qui n’a pas vocation à se substituer à un rendez-vous avec votre courtier d’assurance ou à des recommandations d’ordre juridique, technique et professionnel. Chubb est le nom commercial utilisé pour désigner les filiales de Chubb Limited qui fournissent des services d’assurance et connexes. Pour obtenir une liste de ces filiales, veuillez consulter notre site Web sur www.chubb.com. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Cette communication comporte uniquement des présentations de produit. La couverture est soumise à la langue des polices d’assurance réellement émises.